De l’influence des interfaces
Contexte
Entretien avec Clément Thomas, Thomas Riollet et Arthur Doublet Susini (étudiants de l’école Camondo), édité par Paul Emilieu et Marin Schaffner
Résumé
Avec l’essor du numérique, nos apprentissages comme nos communications sont de plus en plus médiés par des interfaces, des programmes et des machines. Si cela ouvre de nouvelles possibilités, notamment pour l’acquisition et l’échange des savoirs, nous questionnons encore trop peu les contraintes invisibles qui en découlent. Sommes-nous conditionné·e·s par nos interfaces ? Quelle liberté d’usage en avons-nous ? Et comment cela modifie-t-il notre rapport au monde ? Dans cet entretien, Anthony Masure invite à penser les implications socio-politiques et pédagogiques de l’utilisation généralisée d’objets techniques.
Télécharger ce livre en PDF [5 Mo]

Pouvez-vous nous donner une définition simple de ce qu’est pour vous une interface ?
Anthony Masure : Pour la plupart des gens, il y a une confusion entre ce qu’est une interface et un programme numérique. Un programme, c’est basiquement une suite d’instructions rédigées dans un langage de programmation exécutable par une machine. Une interface, elle, est une médiation graphique et technique permettant à un être humain d’accomplir un certain nombre de tâches plus ou moins facilement. Ce n’est donc pas la même chose !
La notion d’interface est une notion complexe qui peut prendre plusieurs sens. Tout d’abord on peut parler, à la suite d’Alexander Galloway, de l’interface comme d’une « zone d’activité autonome », ce qui met l’accent sur ses effets pas toujours désirés. L’autre vision de l’interface, qui est complémentaire de la première, est celle d’une « couche technique ». C’est une idée développée par le théoricien des médias Friedrich Kittler. Kittler ne s’intéresse pas directement aux interfaces, mais plutôt à la façon dont les machines numériques sont en fait constituées de strates quasi archéologiques. Ces couches techniques sont ce qui nous éloigne tout le temps, et de plus en plus intensément, du langage « assembleur » (premier) — ou en tout cas de ce qui serait le plus proche du processeur, c’est-à-dire du cœur de la machine. On peut donc dire qu’une interface est un empilement de couches techniques dont les effets masquent le fonctionnement interne des machines.
Est-il possible de considérer l’interface comme un outil ? Et si oui, que peut- on dire des manières de l’utiliser ?
A.M. : Je ne pense pas que l’interface soit un outil. À vrai dire, je ne pense pas que quoi que ce soit de numérique soit un outil. Il est vrai qu’on dit souvent de tel logiciel « c’est mon outil de travail » ou « ma machine c’est mon outil ». Mais il me semble que dès lors que des objets embarquent des technologies numériques, ces derniers sont liés à la notion de programmation. Dès lors qu’une chose est programmable, selon moi, elle ne peut pas être considérée comme un outil, car elle devient extensible, variable, souple (soft), etc. Un marteau (exemple emblématique de ce qu’est un outil) est certes est préposé à certains gestes, mais il ne contient pas de programmes. Il n’est pas « programmable » au sens numérique.
De fait, on aimerait bien que nos machines numériques, nos logiciels ou les interfaces soient des outils, c’est-à-dire qu’on puisse avoir un certain contrôle sur eux, les manipuler avec nos mains de façon à peu près consciente. Mais dès lors qu’on a des couches techniques qui nous éloignent de leur fonctionnement, on ne comprend pas tout. Il y a toujours des zones d’opacité dans ce type d’objet. Pour ces raisons, il me semble donc que l’appellation d’outil ne peut pas fonctionner. Dans le langage courant on l’utilise, mais il me semble que conceptuellement il y a une erreur.
Mais si je dis qu’outil ne convient pas, il faut bien proposer autre chose. Dans ma thèse j’ai donc développé deux concepts :
Le « dispositif » renvoie, via Foucault et Agamben, à l’idée d’objets techniques très directifs qui imposent des directions et des modes d’emploi de façon autoritaire. Par exemple un téléphone portable peut être un dispositif, de même qu’une caméra de surveillance, un drone, ce genre d’objets. Cela a un sens plutôt négatif.
Le deuxième concept est celui « d’appareil », que j’ai pris chez le philosophe Pierre-Damien Huyghe et qui renvoie à l’idée d’un objet technique qu’on peut régler, paramétrer, mais que nous ne pouvons, malgré tout, jamais contrôler totalement. Quand vous prenez une photographie, il y a toujours un temps où l’appareil travaille sans vous. C’est ce jeu entre contrôle et abandon de contrôle qui définit l’appareil et qui pour moi diffère vraiment de l’outil.
Il reste donc à définir si, selon telle ou telle interface, on a plus affaire à un dispositif ou à un appareil : cela doit être examiné au cas par cas.
En quoi une machine utilisée via des interfaces graphiques ne pourrait- elle pas être considérée comme un outil ?
A.M. : Quand vous créez quelque chose dans Illustrator, qui est l’auteur ? Est-ce vous, ou est-ce Adobe ? La question se pose. C’est un mix, un composite, ce n’est ni l’un ni l’autre et c’est cette symbiose qui est intéressante. Dès lors que vous êtes dans du programmable, vous ne pourrez jamais tout décider. On aimerait bien avoir toujours plus de contrôle, pouvoir dire que c’est nous l’auteur, mais les frontières sont forcément rebattues. L’impression 3D, c’est pareil : vous ne pouvez jamais tout maîtriser. Ce n’est pas possible. Et votre logiciel 3D ? Imaginez que vous vouliez modéliser du mobilier dans un logiciel 3D, votre logiciel va forcément vous pousser vers certaines courbes, certaines proportions.
Les Grecs, par exemple, n’avaient pas de logiciel 3D quand ils concevaient un temple, et ils n’avaient pas vraiment de dessins de conception non plus. Le temple se faisait sur le chantier ; ils sculptaient la pierre sur place. Et pourtant, ils arrivaient à une précision dans la courbure des colonnes qui ne fut découverte que bien plus tard, et qui était destinée à corriger des effets d’optique dans les proportions du temple depuis certains points de vue. Ces courbes, pendant très longtemps, étaient impossibles à reproduire avec des compas. Quand on est passé à la géométrie sur papier, il était difficile de refaire ces formes-là, elles n’étaient pas faites avec les mêmes outils justement.
Sur la 3D c’est pareil : il y a également des courbures très dures à tracer, notamment dans le design automobile : c’est justement pour ça que beaucoup de voitures se ressemblent, c’est parce qu’elles sont faites avec les mêmes logiciels. Et en architecture c’est pareil. Les logiciels nous poussent vers une certaine esthétique (qu’on peut bien sûr dépasser !), cela se démontre dans pas mal de domaines.
En quoi le développement d’interfaces spécifiques peut-il favoriser l’acquisition de savoirs ?
A.M. : En tant que chercheur, je m’intéresse beaucoup à la diffusion de mes recherches. Il y a des statistiques assez terribles qui montrent que la plupart des articles scientifiques sont en fait lus par très peu de personnes, parfois même par une seule personne : leur auteur. On doit donc se demander si on produit vraiment de la connaissance quand personne n’y accède, quand il n’y a pas de partage, pas de véritable diffusion ou discussion.
C’est justement quelques-unes des questions que je me suis posées pour ma thèse. J’ai travaillé 6 ans sur un écrit assez conséquent (550 pages), et j’ai toujours pensé que si personne ne le lisait (à part le jury) cela posait problème. Et donc, comme le sujet de ma thèse traitait des rapports du design aux pratiques de programmations, il m’a semblé logique de concevoir un site Web dédié pour pouvoir lire la thèse en ligne.
J’ai cherché ce qui existait, si quelqu’un avait déjà fait cela en France. On trouve beaucoup de fichiers PDF, qui est un format intermédiaire destiné à l’imprimeur. Même s’il peut être lu sur écran, ce n’est pas très confortable. Au final, j’ai trouvé une seule personne (une seule personne en tout, toutes disciplines confondues !). Cette personne, image avait pris un template Wordpress et y avait copié-collé sa thèse. Je me suis donc dit qu’il y avait là quelque chose d’intéressant à développer, si personne n’avait encore jamais réalisé d’interface de lecture spécifique. J’ai codé directement mon site de A à Z pour ne pas être dépendant de systèmes extérieurs (CMS) — c’est quelque chose qui était important pour moi.
Pour reprendre votre question sur l’acquisition et la transmission des savoirs, évidemment que le Web a été inventé pour ça. Le Web a été (en partie) conçu par Tim Berners-Lee en réaction à des problèmes similaires autour du manque de partage des savoirs. C’est au CERN, un centre scientifique, qu’à la fin des années 1980, Tim Berners-Lee a remarqué qu’il y avait des scientifiques du monde entier qui travaillaient sur des choses tout à fait géniales, mais que peu de collègues sur place connaissaient, et ce d’autant plus à l’échelle mondiale. Il invente donc le Web comme un réseau de partage de contenus de recherche. Alors maintenant, évidemment, il y a tout ce que vous voulez (e-commerce, etc.), mais à la base le Web visait vraiment la transmission des savoirs. Et, malheureusement, si on prend le Web dans sa globalité, je pense que c’est de moins en moins vrai.
En somme la réponse, vous l’avez simplement dans l’histoire des réseaux. Quand le Web devient assujetti à de grandes plateformes propriétaires (image), est-ce qu’il est toujours possible de transmettre des savoirs et des connaissances qui soient libres, non censurables, autonomes, etc. ? Voilà un vrai enjeu.
Que pensez- vous des cours en ligne et de l’apprentissage par le numérique ?
A.M. : Le problème est qu’un environnement numérique de travail ne peut pas pleinement remplacer un cours en présentiel. Le professeur n’est pas toujours indispensable, mais est-il possible d’avoir une interaction aussi profonde avec une interface qu’en présence physique ?
C’est quelque chose d’assez profond de rencontrer quelqu’un . Pour l’instant, nous n’arrivons pas à retrouver dans les environnements numériques la même qualité d’échanges qu’en présence physique. Ce qui se rapproche le plus en termes d’échange se trouve plutôt dans des jeux vidéo ou avec la visioconférence, par exemple. Mais il y a quand même, dans les cas d’échange en face-à-face, une qualité de discussion qui pour le moment n’a pas trouvé d’équivalent avec le numérique.
Mais par contre, je pense que les deux peuvent totalement se compléter. Je suis plus dans cette optique là parce que le numérique permet d’enrichir la dimension collaborative d’un cours au-delà du temps en présentiel.
L’apprentissage par l’erreur est-il possible avec les interfaces ?
A.M. : Avec les interfaces justement, je ne sais pas. En tout cas, moi je dis toujours en début d’année à mes étudiants que je vais les obliger à se tromper, à faire des erreurs, parce que pour moi c’est fondamental. On n’avance qu’en se trompant.
C’est sûr qu’il y a toujours cette peur de l’erreur, car on a tendance à faire le lien entre erreur et échec — du moins dans notre culture française —, et que c’est donc souvent vécu comme quelque chose de négatif. Mais pour moi, c’est très positif de se tromper : ça veut dire qu’on a essayé quelque chose. Il n’y a pas de projets forts derrières lesquels il n’y a pas eu plein d’erreurs et de
remises en question. De ce point de vue, je pense qu’il faut très vite, dans la pédagogie, dédramatiser l’erreur. J’irais même plus loin : je pense que le professeur doit provoquer l’erreur de la part de ses étudiants : cela leur permettra de se confronter à l’erreur pour la vivre positivement. Après, bien entendu, tout dépend de ce qu’on fait de l’erreur. C’est là toute la question. Si l’on se trompe et qu’on ne rebondit pas, cela ne sert à rien. Mais l’erreur finit toujours pas aboutir sur quelque chose, il me semble.
Donc, des interfaces d’apprentissage qui laisseraient la place à l’erreur, je crois que ça n’existe pas vraiment. Je ne connais pas bien ce domaine, mais si on regarde les cours en ligne, je ne pense pas que l’erreur soit très présente dans les interfaces. Cela va donc à l’encontre de ce que je viens de défendre, mais c’est aussi et surtout parce que c’est compliqué à programmer. Il y a un défi de conception à pouvoir inventer des interfaces faisant place à l’erreur de façon positive. L’erreur est une question d’interprétation. Or, on a du mal, dans le numérique, à créer des interfaces interprétatives – ce qui est une qualité humaine assez fondamentale, alors que le programme numérique, lui, va plutôt être une logique rigide. L’interprétation, c’est une certaine souplesse de vue que l’on a du mal à trouver dans le numérique. Dans le jeu vidéo, certes vous apprenez par l’erreur en quelque sorte, mais au final, cela reste un score et les réactions de l’environnement sont déjà pensées pour réagir aux diverses erreurs des joueurs. L’enjeu, pour moi, c’est que dans l’erreur il y a plein de nuances.
Mais peut-on laisser place à l’imprévu dans des interfaces ?
A.M. : Justement, c’est complexe car un programme numérique, par définition est quelque chose d’écrit à l’avance (pro-gramme). Pourrait-on penser des programmes d’une autre nature qui laisseraient place à des choses qui ne soient pas dirigées d’avance ? Il n’y a pas énormément d’exemples de ce type, mais sans doute que des pratiques de design et des pratiques artistiques permettraient de créer ce genre de programmes.
Mais si l’on fait à nouveau un parallèle avec le cours d’un enseignant, les choses ne peuvent jamais y être totalement écrites. Les personnes apprennent à différentes vitesses. Cela arrive également que les étudiants, par leurs questions, fassent basculer le cours dans une direction inattendue. Et c’est d’ailleurs précisément ici que c’est passionnant : quand il y a un vrai échange qui remet en cause la hiérarchie. Dans les meilleurs moments, j’apprends autant de mes élèves qu’ils apprennent de moi. Effectivement, donc, la pédagogie c’est un art de l’imprévu, de l’acquisition de connaissances ou de compétences possibles grâce à une certaine souplesse. Sans souplesse l’imprévu est impossible dans la pédagogie.
Le numérique reviendrait- il donc à programmer l’imprévu ?
A.M. : En fait l’imprévu n’existe pas dans le programme en tant que tel car l’aléatoire est pratiquement impossible à obtenir mathématiquement, mais il réside plutôt dans l’interprétation elle-même qu’on se fait du fonctionnement du programme. Il peut donc y avoir une illusion de l’imprévu.
Le programme n’est pas autonome, notamment dans l’apprentissage. C’est toujours un programme qui est lu, exécuté, consulté par un humain et, dès lors qu’il y a un humain et qu’il y a relation humain-machine, l’imprévu ne peut se trouver que du côté de celui qui va interpréter le fonctionnement à l’écran ou ce qui se passe à l’écran. C’est seulement là que quelque chose comme de l’imprévu pourrait exister. Pas directement au niveau du programme, donc, mais au niveau des effets que ça va renvoyer. L’imprévu vient de l’interaction entre humain et machine. On pourrait donc imaginer qu’un programme, de façon calculée, écrite au préalable, vous renvoie quelque chose qui va surprendre vos attentes. Donc, la seule chose que l’on puisse faire, me semble-t-il, c’est, lors de la création du programme, de provoquer des effets qui seront interprétés comme imprévus.
Et qu’en est-il de la licence libre, puisqu’elle permet à chacun de s’approprier le programme ?
A.M. : Ma thèse est sous licence libre. C’était quelque chose de très important pour moi. Il ne suffisait pas d’en faire un site Web, il fallait aussi aller plus loin et permettre aux gens d’en faire ce qu’ils veulent, de publier et republier. Je pense qu’il est nécessaire de sortir du modèle auteur-propriétaire. Si je mets quelque chose en licence libre, ça ne m’appartient plus vraiment et je ne peux pas décider de ce qui va en être fait. Pour moi, c’est une chance de pouvoir donner la possibilité à d’autres d’inventer autre chose que ce qu’on avait prévu. L’imprévu peut résider dans l’interprétation, dans le réemploi, dans la réutilisation, dans le détournement de ce que d’autres personnes peuvent faire. Effectivement, les licences libres permettent cela mais il ne suffit pas que les programmes soient sous licence libre, il faut aussi que le code puisse être compris facilement. Il faut donner envie à une communauté de gens en ligne de se servir de la licence, c’est aussi un travail de communication. Mettre des choses en ligne sous licence libre ne suffit pas !
Y a-t-il une dimension éthique à tout cela ?
A.M. : Dès lors qu’on parle de programmes et d’algorithmes, on peut se poser des questions éthiques, mais le mot n’est pas forcément le bon. Cela devient politique par contre, c’est certain. Si vous regardez l’histoire des logiciels libre, vous retombez notamment sur les quatre libertés du logiciel libre de Richard Stallman qui partait d’une frustration d’une imprimante qui « buggait ». Quand Stallman voulut inspecter le fonctionnement du programme de l’imprimante, il fut bloqué par le code propriétaire de l’imprimante. Il a donc créé ce manifeste face aux éléments figés des licences propriétaires. C’est ce qui a lancé le mouvement du logiciel libre. Il y a certes une éthique de la conception, mais le mot éthique ne me semble pas le mieux adapté, car quand vous créez une interface vous la créez pour les autres. Je dirais donc que c’est plutôt moral — même si le mot de « morale » est actuellement vu négativement dans le langage courant. Une interface est forcément chargée d’une vision politique et économique, d’une certaine vision du corps social. Par conséquent, la question est : est- ce que la personne qui pratique l’interface a conscience des enjeux politiques qui y sont liés ? Est-ce que c’est visible et intelligible ?
La plupart du temps ça ne l’est pas et donc ça bloque, en tout cas ça ne favorise pas l’esprit critique vis-à-vis des interfaces. Peut- être que le logiciel libre permet d’expliciter davantage cette vision politique ou cette vision économique. La question n’est pas de savoir s’il y a une éthique ou s’il n’y en a pas, car il y en a forcément une. La question est plus de savoir si on peut comprendre l’éthique, la critiquer, proposer autre chose.
Le problème dans la discussion est qu’on associe éthique à quelque chose qui est positif, mais je pense que chacun a son éthique propre. La question qu’il faut se poser avant tout est : est-ce souhaitable humainement ? Est ce que cela participe à la construction d’une société dans laquelle on aimerait vivre, qu’on aimerait voir ?
Tout être humain a une éthique, mais est ce que ça permet de vivre ensemble ? Qu’est- ce qui fait que différentes éthiques peuvent former un corps social dans lequel les gens ne vont pas s’entretuer ? On en revient donc à la notion de morale. Et donc, si je reformule votre question : est-ce qu’une interface propriétaire sera forcément chargée de valeurs morales négatives ? Je dirais que dans le « libre », vous pouvez trouver des choses immorales. Ce n’est pas parce que vous pouvez réutiliser le code source que l’usage est forcément bon. On parlait d’impression 3D, eh bien ça fait quelques années qu’on peut trouver sur le Web des plans d’impressions d’armes à feu sous licence libre, que vous pouvez donc imprimer chez vous. Est-ce que le fait que ça soit sous licence libre participe d’une éthique positive ? Ici, pas forcément. Donc on se rend bien compte que le fait de fonctionner sous licence libre ne suffit pas à être moralement bon. L’opposition libre/propriétaire ne suffit pas à créer un monde affranchi d’un côté ou de l’autre.
Pour revenir sur l’apprentissage via le numérique, il y a quand même des statistiques intéressantes à analyser. Par exemple, certains pays ont « massifié » l’usage des tablettes dans l’enseignement et font maintenant machine arrière en se rendant compte que cela a fait régresser la qualité des cours. Il y a aussi ces grands groupes technologiques, les GAFAM de la Silicon Valley, dont les enfants sont mis dans des écoles totalement déconnectées. C’est un constat intéressant. On n’a sûrement pas assez réfléchi à des complémentarités dans l’usage du numérique avec le monde physique.

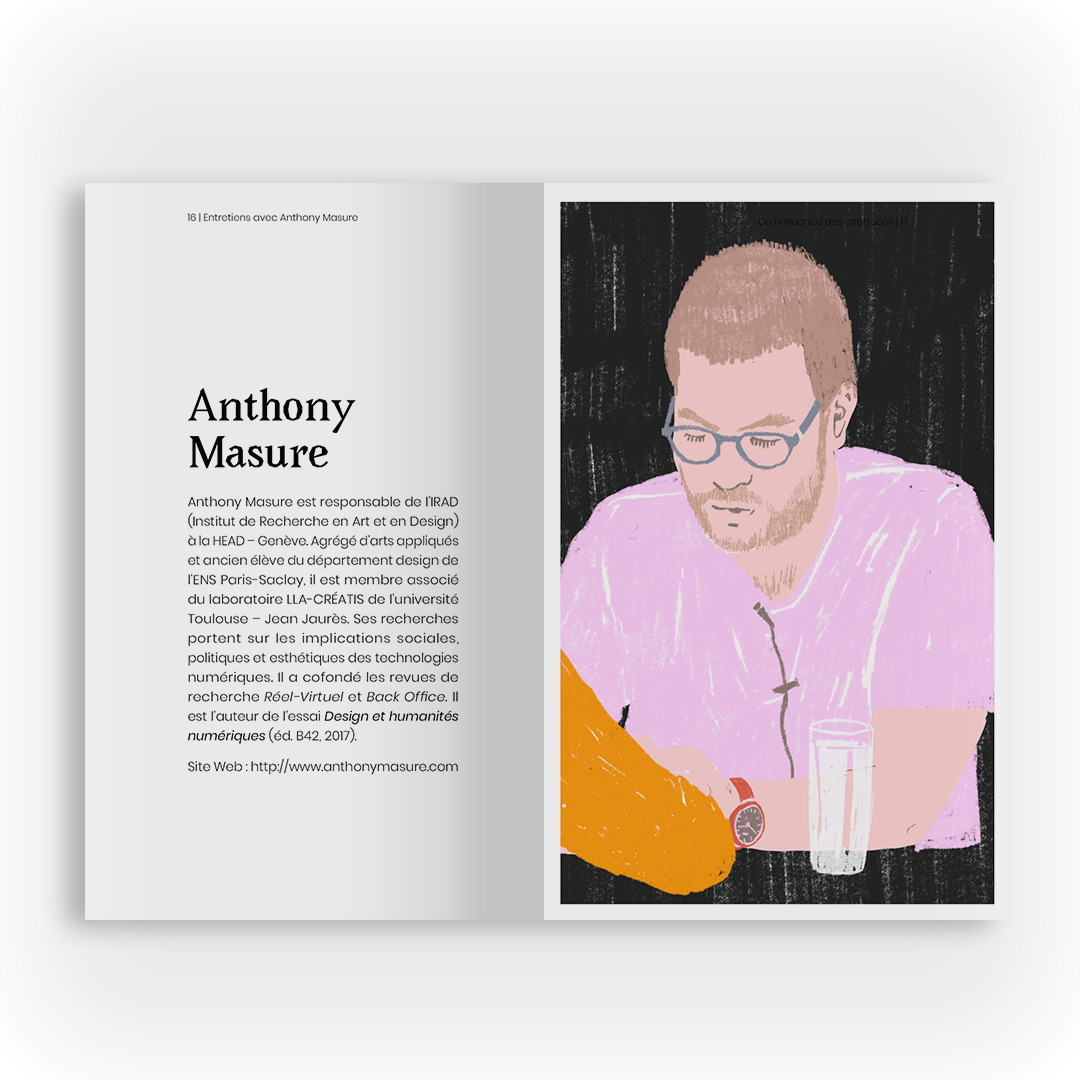
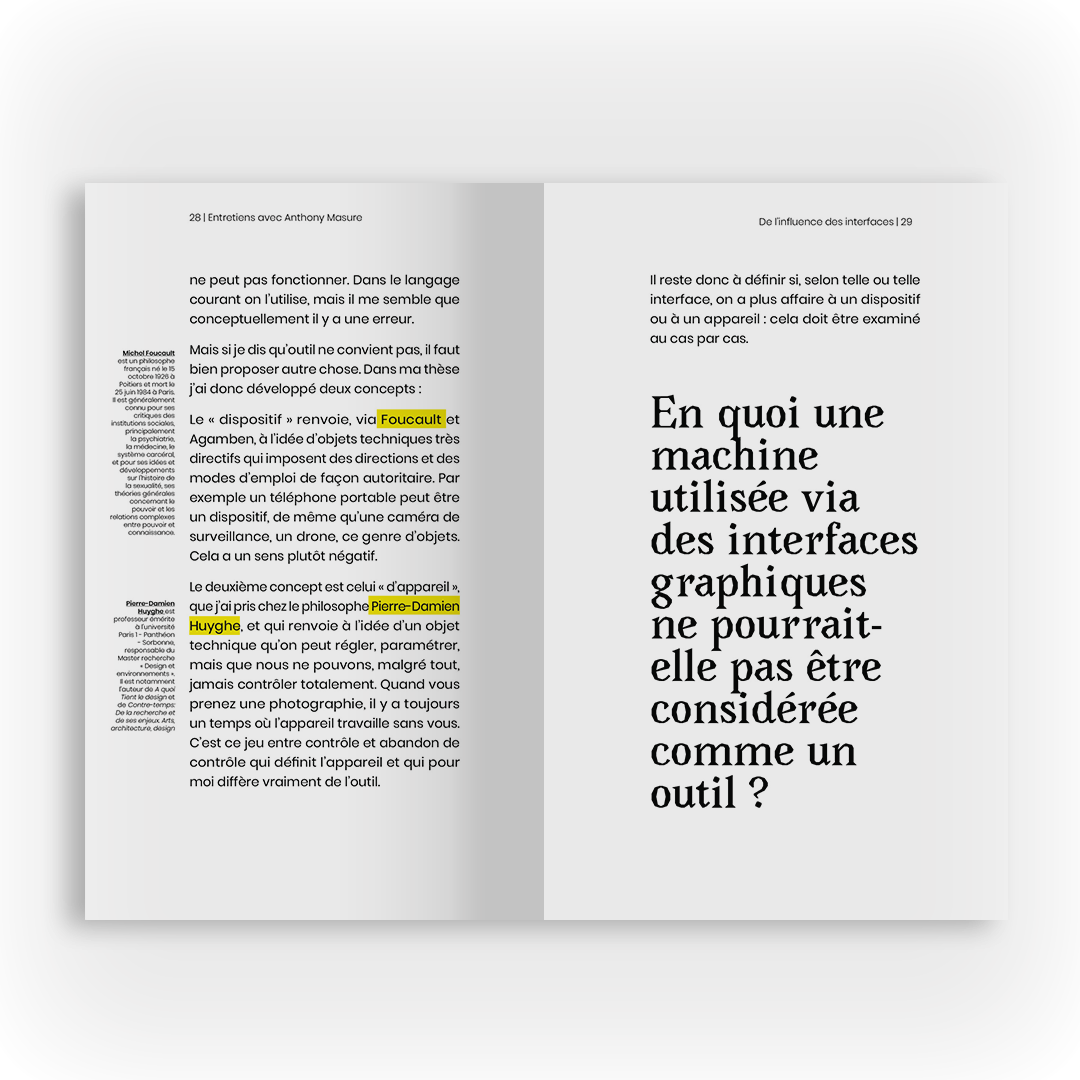

Format : 100 × 160 × 5 mm
Pages : 55 p.
Composition : Emilieu
Illustration : Lola Peugnet
Texte sous licence libre CC BY-SA
Diffusion : Emilieu
ISBN : 978-2-9570124-0-4