Peut-on encore ne pas travailler ?
Résumé
Tandis que le travail, en crise, est de plus en plus recherché, mince est la limite entre des emplois salariés, pour lesquels il faut en faire toujours plus, et une myriade de micro-tâches non rémunérées, qui donnent l’impression de travailler jour et nuit. Autrement dit : peut-on encore ne pas travailler ? Afin de traiter ce paradoxe, nous examinerons tout d’abord le passage du métier à des professions employées à faire croître le capital. Ensuite, après avoir vu en quoi l’époque contemporaine pourrait signer une possible « mort de l’emploi », nous analyserons en quoi le développement du « labeur numérique » (digital labor) et des objets supposément « intelligents » (smart) brouille la distinction entre le temps libre et le temps travaillé. Afin de sortir de ces impasses, nous nous demanderons si le design, en tant que travail de « qualités » inutiles, pourrait permettre d’envisager de nouveaux rapports au temps.
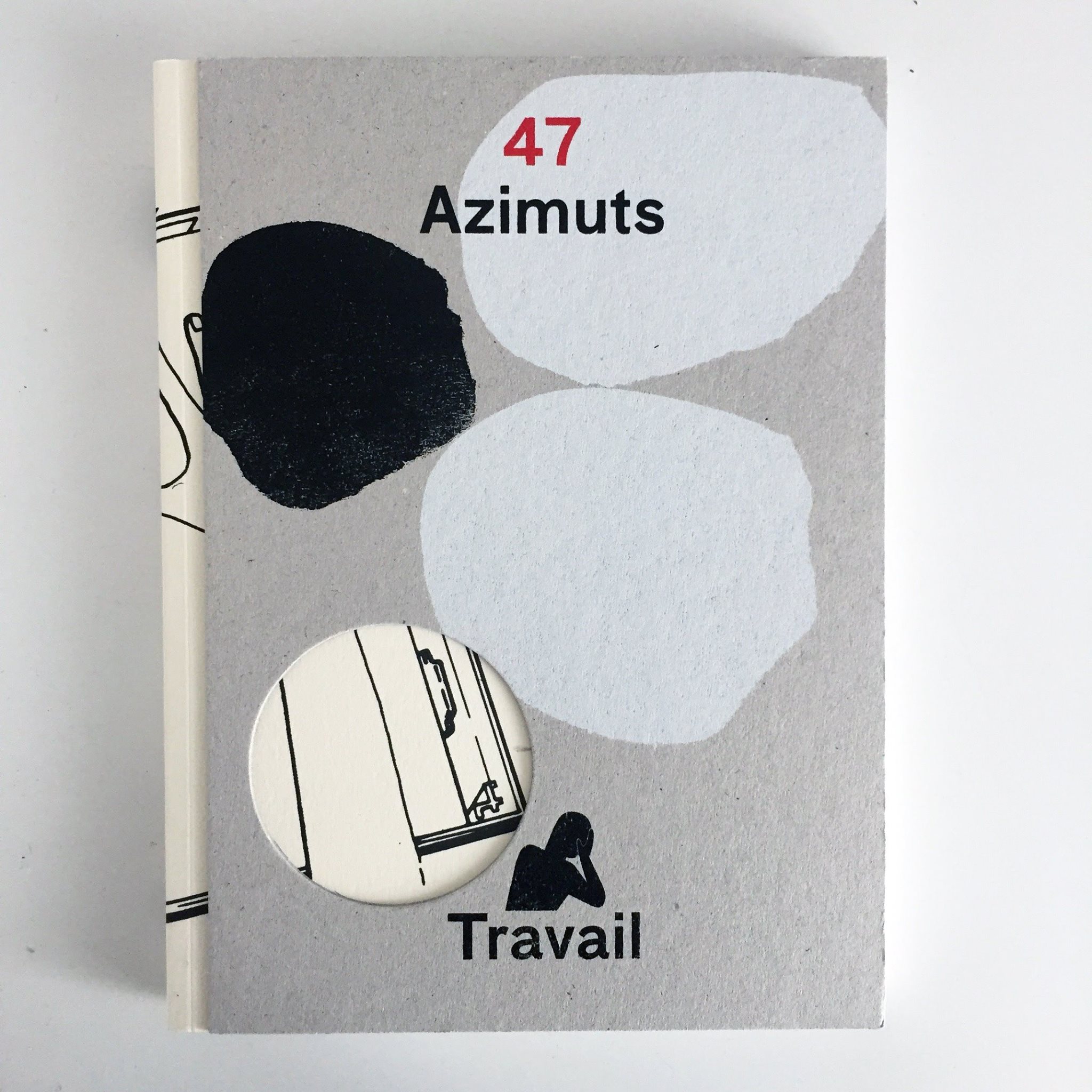
C’est la crise , paraît-il. Économique, environnementale, politique, sociale, etc. Dans le contexte français, entre les cris d’orfraies des partisans d’un État régulateur et les zélateurs du libre échange, de nombreuses revendications convergent vers la notion de travail, elle aussi en crise. Il n’y en aurait plus : disparu ! Les yeux rivés sur les statistiques du chômage, dont les méthodes de calcul sont pourtant soumises à de nombreux biais, les dirigeants politiques et autres « agences de notation » font du travail le critère de réussite ou d’échec des gouvernances successives. Mais comme l’élaboration du « produit intérieur brut » (PIB) ne prend pas en compte de nombreux paramètres essentiels à la cohésion du corps social (écologie, éducation, bien-être, bénévolat, travail domestique, etc.), on peut dès lors s’interroger sur la pertinence d’évaluer le travail en raison de performances économiques : ce qui compte pour nous n’est pas compté.
Le critique d’art Jonathan Crary, dans son essai 24/7 1 Jonathan Crary, 24/7. Le capitalisme à l’assaut du sommeil, Paris, Zones, 2014., a ainsi mis en évidence que les mutations contemporaines du capitalisme, en quête d’une croissance infinie, ont pour ambition de faire disparaître le sommeil, ce temps mort de la productivité. Bardé de capteurs et aidé par des drogues qui le maintiennent dans un état de vigilance continue 2 L’épisode 5 de la 3e saison de la série Black Mirror (« Men Against Fire », scénarisé par réalisé par Charlie Brooker et réalisé par Jakob Verbruggen) en donne une vision saisissante : des soldats équipés d’implants cérébraux sont dressés à ne plus ressentir d’empathie pour l’ennemi. Afin de les maintenir dans un état de vigilance continue, leur sommeil est « géré » par la génération de rêves fantasmatiques, devenant ainsi un instrument de contrôle., le soldat américain devient ainsi l’idéal du salarié du tertiaire — à qui l’on demande de pouvoir opérer à toute heure et en temps réel la gestion de flux d’informations et de prises de décision. Plus encore, à ces limites du salariat contractualisé s’ajoutent un ensemble de micro-tâches (notamment en ligne) non identifiées, du moins symboliquement et économiquement, comme relevant de la sphère du travail. Ainsi, la quantité et la diversité des différentes formes que peut prendre le travail ne cesse d’augmenter, ce qui menace la possibilité d’un temps authentiquement libre. Autrement dit : peut-on encore ne pas travailler ?
Pour répondre à cette question, il faut tout d’abord examiner la mutation de la notion de métier en profession à l’époque des Lumières, puis le développement du capitalisme au tournant de la révolution industrielle. Ensuite, après avoir vu en quoi l’époque contemporaine pourrait signer une possible « mort de l’emploi », nous verrons que les limites du travail n’ont jamais été aussi floues, tant du point des vues d’activités en ligne non rémunérées (« labeur numérique ») que de la prolifération d’objets supposément « intelligents » (smart) qui brouillent encore plus la distinction entre le temps libre et le temps travaillé. Afin de sortir de ces impasses, nous nous demanderons si le design, en tant que travail de « qualités » inutiles, pourrait permettre d’envisager de nouveaux rapports au temps.
Du métier aux professions contractualisées
La compréhension moderne de la notion de travail doit être resituée à l’aune de la séparation des notions de « métier » et de « profession ». Historiquement, le métier renvoie à une certaine faculté technique, c’est-à-dire à un ensemble de compétences pratiques relatives au maniement d’un outillage. Or la figure de l’artisan, comme le fait remarquer le philosophe Pierre Damien Huyghe 3 Pierre-Damien Huyghe, « Le principe du métier », Ateliers d’Art, no 100, juillet-août 2012, p. 56-58., est définie dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1751–1772) à partir d’une séparation entre les notions de métier (l’habileté technique) et de profession (sa mise au service d’une commande). Dans ce contexte, l’artisan est donc moins une figure idéalisée (qu’il faudrait aujourd’hui retrouver) que l’expression d’une force d’exécution servile (par exemple, l’auteur est celui qui fournit à l’artisan le patron du vêtement à réaliser). L’époque de la modernisation industrielle à la fin du XIXe siècle, toujours selon Pierre-Damien Huyghe, poursuit cette dynamique. La « contractualisation » du travail met en concurrence des individus en leur offrant des activités économiques qui ne possèdent plus leurs outils de travail (leurs « métiers »). Cette transformation du métier en profession fait qu’il n’est plus besoin d’avoir des compétences techniques pour travailler. À un certain moment, l’industrie passe un seuil (c’est « la grande industrie » dont parle Karl Marx 4 Karl Marx, Manuscrits de 1844, trad. de l’allemand par Jean-Pierre Gougeon, Paris, Flammarion, 1999.) qui l’éloigne définitivement de la manufacture, de ce que le métier gardait encore de marge de manœuvre et de possibilité de maniement 5 Voir : Sophie Fétro, « Œuvrer avec les machines numériques », Back Office, no 1, février 2017, p. 86-97.. Placé au service de machines qui l’aliènent, l’ouvrier devient, selon Marx, un prolétaire : quelqu’un qui a été dépossédé de son outil de travail. Plus d’un siècle après Marx, la philosophe Hannah Arendt prolonge ces réflexions en reliant historiquement l’apparition des prolétaires au développement des « marchés d’échange ». Les personnes qui s’y rencontrent ne sont plus des travailleurs considérés comme des individus doués de subjectivité, mais comme des entités qui ont comme seule possibilité de louer leur force de travail. La séparation entre « travail » et « capital » (Marx) les transforme en marchandises échangeables et économisables :
« [La manufacture ne juge l’individu que sous l’angle de sa productivité] tandis qu’aux yeux de l’homo faber la force de travail n’est qu’un moyen en vue d’une fin nécessairement plus haute, objet d’usage ou objet d’échange, la société de travail confère à la force de travail la même valeur supérieure qu’elle attribue à la machine. […] Le prix du travail humain augmente à tel point qu’il peut paraître mieux apprécié et plus précieux que toute matière ou tout matériau donnés ; en fait, il ne fait qu’annoncer quelque chose d’encore plus « précieux », à savoir le parfait fonctionnement de la machine dont la formidable force de fabrication commence par tout normaliser avant de tout dévaluer en faisant de tous les objets des biens de consommation 6 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne [1958], trad. de l’anglais par Georges Fradier, Paris, Pocket, coll. Évolution, 2001, p. 217.. »
Dégradés et réduits à leur seule « valeur d’échange » commerciale, les travailleurs ne sont qu’une pièce parmi d’autres du rouage industriel, qui ne produit que des marchandises consommables. La monnaie d’échange homogénéise tous les objets, êtres vivants, œuvres d’art en les soumettant à une économie qui les dévalue en les « employant », c’est-à-dire en en usant en vue d’une fin. Employer, du latin implicare : « plier dans », « fait d’user de quelque chose », induit déjà, par opposition au métier, l’idée d’une mise à disposition servile. Le corps de l’ouvrier se plie dans le dispositif machinique de l’usine, dont il n’est qu’un rouage temporaire. Rapporté à l’efficacité du rendement obtenu, rares sont les corps humains dans les technocentres et les chaînes de montage automatisées que nous connaissons aujourd’hui.
Cette première séparation conceptuelle entre les capacités techniques d’un individu et leur asservissement (voire leur aliénation) au sein de tâches d’exécution recouvre déjà des problématiques contemporaines : qu’en est-il du « principe du métier » (Huyghe) dans une société marquée par la contractualisation des professions ? Autrement dit, est-il certain que toutes les compétences qu’un individu est en capacité d’exercer et de développer s’épuisent dans leurs applications économiques ?
Vers une fin de l’emploi ?
C’est précisément cet écart qui sépare le travail de l’emploi. Les situations d’emploi se caractérisent par un asservissement à une entité extérieure dans laquelle l’habileté technique et intellectuelle est subordonnée à un principe de rentabilité. On parle ainsi de « mode d’emploi » pour désigner une utilisation recommandée qui, si elle n’est pas correctement suivie, ne permettra pas d’obtenir les objectifs prévus. Dans l’acception actuelle du terme, l’emploi est une économie du travail, au sens où il lui fournit un cadre juridique ainsi qu’un statut temporel et géographique. À ce titre, un livre comme Emploi et travail, le grand écart (2007) est significatif d’une époque qui peine à penser la possibilité d’un travail sans emploi :
« L’emploi ne dit rien du travail, il délimite son champ. L’emploi confère un statut, y compris à ceux qui en cherchent un et ne l’ont pas encore trouvé ou l’ont perdu. À l’exception d’îlots de plus en plus réduits de travail indépendant (agriculture, artisanat, professions libérales), hors de l’emploi, il n’y a pas de travail. […] Dans une société salariale, c’est l’emploi qui a un prix et non le travail. Le prix de l’emploi donne sa valeur au travail 7 Françoise Piotet, Emploi et travail, le grand écart, Paris, Armand Colin, 2007, présentation du livre par F. Giraud.. »
On pourrait objecter à ce constat que réduire le travail au prix d’un emploi revient à faire de toute situation de vie une recherche de production de « valeur ». Le philosophe Bernard Stiegler propose ainsi une nouvelle acception du terme de « prolétaire », en associant la perte des savoir-faire à celle des savoir-vivre. Le « temps du mal-être 8 Bernard Stiegler, La technique et le temps, tome 3, Le temps du cinéma et la question du mal-être, Paris, Galilée, coll. La philosophie en effet, 2001. » est celui d’une époque qui évacue la notion de travail en opposant l’emploi au chômage. Par exemple, le scientifique n’a qu’une vision restreinte de sa discipline, le chef d’entreprise vit mal des logiques économiques qui lui échappent, etc. Le devenir consommateur s’applique à toutes les facettes de la vie, cherchées, identifiées, modélisées et capitalisées l’une après l’autre :
« Le consommateur de la société hyperindustrielle est un consommateur qui se déqualifie à toute vitesse — et qui du même coup se désindividue, comme l’avait montré [Gilbert] Simondon pour le producteur. Il ne sait plus « faire à manger », il ne sait plus compter. Bientôt il ne saura plus conduire, sa voiture conduira toute seule. Les consommateurs sont préformatés dans leurs comportements de consommation, téléguidés, conditionnés, et, comme dit [Gilles] Deleuze, « contrôlés » 9 Bernard Stiegler, « Quand s’usent les usages : un design de la responsabilité ? », entretien avec Catherine Geel, Saint-Étienne, Cité du Design, Azimuts, no 24, 2004, p. 85.. »
Comme le montre Bernard Stiegler, l’arrachement au temps de la tradition fait apparaître des pratiques « prescrites par des modes d’emploi et des campagnes publicitaires 10 Bernard Stiegler, « Quand s’usent les usages : un design de la responsabilité ? », op. cit. ». Dans la consommation, l’objectif n’est plus de répondre à une commande comme c’était le cas dans la profession, mais de faire de l’objet même de la consommation l’horizon du travail — réduit ici à sa forme larvée, pour ainsi dire spectrale. Alimentant et tirant profit de la disparition des métiers, voire des professions, des sociétés « de service » fournissent clé en main nourriture, amour, vacances, connaissances, langues, éducation, loisirs, etc.
Au capitalisme industriel (concentration des moyens de production) se sont ainsi ajoutés le capitalisme financier (ère de la spéculation et domination des institutions financières) puis le capitalisme cognitif 11 Voir par exemple le dossier « Finance, rente et travail dans le capitalisme cognitif » dirigé par Yann Moulier-Boutang dans : Multitudes, no 32, printemps 2008. (captation de la production de connaissances). En résulte un développement accru de techniques d’automatisation 12 Voir : Bernard Stiegler, La Société automatique, tome 1, L’avenir du travail, Paris, Fayard, 2015. visant à remplacer, avec plus ou moins de succès, nombre de professions installées : taxis (voitures sans chauffeurs), journalistes (bots d’écriture), secrétaires (intelligences artificielles), avocats (algorithmes prédictifs), designers (développement du design génératif et paramétrique, templates), etc. Ainsi, appréhender le numérique comme un gisement économique semble bien naïf au regard d’une « mort de l’emploi 13 Bernard Stiegler, Ariel Kyrou, L’emploi est mort, vive le travail !, Paris, Mille et une nuits, 2016. » (Stiegler), cette désintégration du travail [représentant] la facette aveugle et mécanique de nos activités rémunérées, qui se conjugue si aisément avec l’automatisation des esprits 14 Ibid. ».
Des data aux capta, le labeur numérique
À cette situation, qui ne profite qu’à un petit nombre, s’ajoute une tendance parallèle consistant à s’accaparer un très grand nombre d’actions opérées en ligne afin de renforcer la valeur de « plateformes » qui les centralisent et qui, dès lors, les privatisent. Nous ne sommes plus dans le registre de la connaissance modélisable (capitalisme cognitif), mais bien dans ce que le sociologue Dominique Boullier appelle un « âge de la prédation 15 Dominique Boullier, « L’âge de la prédation », InternetActu.net, septembre 2012, Cet article est une réponse au livre de Nicolas Colin et de Henri Verdier L’âge de la multitude. Entreprendre et gouverner après la révolution numérique (2012). ». Il s’agit ici, dans le prolongement des thèses de Luc Boltanski et Ève Chiappello 16 Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999., de « capter » la créativité de la « multitude ». Ainsi, quand je like, que je commente ou que je publie un message publié sur média social, je renforce sa valeur financière en générant du temps d’activité (qui apparaîtra dans son bilan d’activité), en créant du contenu (qui pourra générer d’autres interactions), et en lui fournissant des informations personnelles (métadonnées : heure et lieu de connexion, etc.). En plus de problématiques liées à la vie privée 17 Voir : Tristan Nitot, Surveillance://, Caen, C&F, 2016., les données, une fois captées, pourront servir à optimiser le ciblage de contenus publicitaires supposément « personnalisées » 18 Là où les compagnies de cartes bleues type VISA peuvent savoir quand un couple va divorcer, Facebook serait capable de prédire l’évolution des sentiments amoureux par une analyse sémantique des interactions.. Un autre exemple paradigmatique est celui du programme ReCaptcha, un service gratuit permettant de distinguer sur le Web un être humain d’un robot en lui faisant recopier les caractères alphanumériques d’une photo ou d’un scan : chaque utilisation de cet outil contribue à améliorer la précision des services Google Books ou Google Street View. Il en va encore de même lorsque nous effectuons une requête sur un moteur de recherche privatif (nous participons à son amélioration), ou encore lorsque nous évaluons la qualité d’une location d’appartement (AirBnB), d’un chauffeur (Uber). « Quelqu’un, quelque part, finira par vous évaluer en tant que passager, hôte de maison d’hôtes, étudiant, patient, client 19 Evgeny Morozov, « La prise de pouvoir des
données et la mort de la politique », Blog de Paul Jorion, août 2014. » note, grinçant, le chercheur et journaliste Evgeny Morozov.
Cette « économie de l’attention 20 Voir : Yves Citton (dir.), L’économie de l’attention, Paris, La Découverte, coll. Sciences humaines, 2014. » — au sens où mes actions sont transformées en situations qui « économisent » mon environnement attentionnel — participe du monopole des GAFAM 21 Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.. Nous ne sommes pas ici dans des situations d’emploi (contractualisées), mais nous sommes pourtant « employés », c’est-à-dire mis au service de finalités qui nous dépassent. Ces micro-tâches non rémunérées, assimilables à du travail, sont analysées par le chercheur Trebor Scholz comme relevant d’un « labeur numérique (digital labor) 22 Trebor Scholz (dir.), Digital Labor. The Internet as Playground and Factory, New York City, Routledge, 2013. Voir aussi : Dominique Cardon, Antonio A. Casilli, Qu’est-ce que le Digital Labor ?, Paris, INA, coll. « Études et controverses », 2015. », expression qui retrouve l’étymologie douloureuse du terme « travail » (du latin trepalium, nom d’un instrument de torture). Mais c’est aussi, et surtout, la notion de travail qui s’en voit bouleversée. Le sociologue Antonio Casilli note de façon ironique que ce labeur sournois, masqué, participe d’un mélange des genres :
« On ne sait jamais si on s’amuse ou si on produit de la valeur pour quelqu’un. Quand je like quelque chose, est-ce que je fais un signal amical à quelqu’un ou est-ce que je produis de la valeur pour la plateforme que j’utilise 23 Hubert Guillaud, « Digital Labor : comment répondre à l’exploitation croissante du moindre de nos comportements ? », InternetActu.net, 12 novembre 2014. ? »
Extension du domaine du travail et mort de la politique
Cette confusion entre jeu, loisir et travail fait qu’on ne sait plus différencier le temps libre d’activités ayant pour finalité un rendement. On peut dès lors se demander s’il est toujours possible de ne pas travailler, tant toutes les poches de nos existences sont susceptibles d’être accaparées. Le développement des objets « connectés » ouvre ainsi de nouvelles perspectives au labeur numérique. Quand je dors à l’aide d’un masque de sommeil dit « intelligent », des données sont collectées, qui peuvent servir à améliorer le produit, à établir des statistiques 24 Claire Richard, « L’homme le plus connecté du monde s’est fait dévorer par ses données », Rue89.NouvelObs.com, 9 septembre 2016., voire à être revendues (assurances 25 Graham Ruddick, « Admiral to price car insurance based on Facebook posts », TheGuardian.com, 2 novembre 2016., etc.). Au-delà de cette reformulation des thèses de Jonathan Crary (le sommeil est toujours présent, mais celui-ci fait désormais l’objet d’une rente), il en va de même, par exemple, si je me brosse les dents 26 James Vincent, « This smart toothbrush claims to have its very own ’embedded AI’. Don’t blame me, I didn’t invent capitalism », TheVerge.com, 4 janvier 2017. ou si je me coiffe 27 Karissa Bell, « L’Oreal’s smart hairbrush can tell you if you’re ruining your hair », Mashable.com, 4 janvier 2017. avec un dispositif embarquant une supposée « intelligence artificielle » (AI), si je remplis mon smart fridge, ou encore si j’utilise un sextoy connecté, dont un procès récent 28 Manon des sources, « Les soucis judiciaires du We-Vibe, un sextoy un peu trop connecté », LeTagParfait.com, 19 décembre 2016. montre que la gestion des données privées est encore très aléatoire. Ce qui pose problème ici est moins l’obsolescence annoncée de ces smart objets 29 « ‹ Smart › is the deodorant for bad ideas – a magic adjective that makes horrible products less stinky. » : tweet de Evgeny Morozov du 6 janvier 2017. et les risques liés à leurs failles de sécurité (hacking, etc.), que le fait qu’ils fonctionnent, de façon symptomatique, en sous-main, sans passer dans le registre du visible. Qui sait, par exemple, que tous les arbres de la ville de Paris sont équipés depuis 2006 de puces RFID permettant la mesure d’indices de pollution ? De même, la mise en place du compteur « intelligent » EDF Linky fait débat : est-ce en raison d’une résistance « par principe » à la nouveauté technique, ou est-ce parce que sa conception opaque ne permet pas de comprendre les modalités de transmission et de stockage des informations 30 Voir : Anthony Masure, « L’intelligence en défaut des smart cities », RevueSurMesure.fr, 5 janvier 2017. ?
Selon Hannah Arendt, le « domaine public » se caractérise par le fait que chacun peut voir et entendre la place de l’autre, différente de la sienne 31 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, op. cit., p. 97-98.. Sans cette distinction, il ne saurait exister de lieu de rencontre, et donc de débat politique. Aussi, ces activités quotidiennes économisées en jeu (« gamifiées ») pour ne pas paraître laborieuses posent directement un problème politique, tant que les revenus dégagés (soustraits en grande partie à l’impôt) et que les modes de gouvernance (qui prennent la forme de « conditions d’utilisation » formulées pour ne pas être lues) échappent à la délibération collective — et se placent dès lors hors du domaine public qui caractérisait encore les « marchés d’échange » du capitalisme naissant. Evgeny Morozov parle ainsi de « réglementation algorithmique 32 Evgeny Morozov, « La prise de pouvoir des données et la mort de la politique », op. cit. » pour pointer le fait que chacune de nos actions est susceptible d’être enregistrée, quantifiée et corrigée, y compris par des États. Ces derniers utilisent les mêmes procédures de gestion et de management que les grands groupes technologiques, « faisant [ainsi] de la psychologie comportementale le discours favori de la bureaucratie gouvernementale [et] effaçant tout ce qui existe comme différences entre les secteurs de la société 33 Ibid. ». Selon Morozov, ce passage du politique à la gouvernance (au pilotage) va de pair « avec la prolifération croissante de procédures de contrôle dans la vie quotidienne — par le biais de distributeurs de savon et de voitures gérées à distance 34 Ibid. ». De même, le chercheur Christian Fauré 35 Christian Fauré, « De la bureaucratie en Amérique », 18 octobre 2015, Christian-Faure.net : « D’ailleurs, combien d’applications de smartphones ne sont-elles rien d’autres que de nouveaux formulaires à remplir, même si elles nous sont présentées comme de ‹ simples formalités › ? » note avec acuité que cette « naturalisation de la bureaucratie » se prolonge dans la vie quotidienne via la profusion de courriers postaux ou numériques 36 Céline Mordant, « Droit à la déconnexion : y a-t-il une vie après le travail ? », LeMonde.fr, 17 mars 2016., et d’autre part, de façon plus insidieuse, dans les « formulaires » numériques à compléter des services en ligne, dans les « notifications numériques 37 « Archéologie des notifications numériques », communication avec Saul Pandelakis dans le cadre du colloque scientifique « Archéologie des médias et écologies de l’attention », dir. Yves Citton, Emmanuel Guez, Martial Poirson et Gwenola Wagon, Cerisy-la-Salle, juin 2016. » et autres « applications » (jeux, calendrier, etc.) — d’où cette impression diffuse de travailler continuellement alors même que nous n’aurions, du moins en occident, jamais eu autant de temps libre 38 Aurialie Jublin, « Comment l’employabilité a-t-elle tué le temps libre ? », InternetActu.net, 2 novembre 2016..
Travailler hors de tout calcul
Ce brouillage menace la distinction fondamentale que faisait Hannah Arendt entre la vie active (vita activa) et la vie contemplative (vita contemplativa) 39 Hannah Arendt, op. cit., et sans laquelle l’existence humaine perdrait son authenticité. Il n’est donc pas souhaitable que l’emploi, l’employabilité, délimitent le champ du travail. Aussi, plutôt que de chercher à sauver l’emploi, qui comme nous l’avons vu, a largement perdu de sa consistance, il faut plutôt œuvrer à redonner du sens au travail — compris non pas comme une souffrance (labeur) ou comme une activité récurrente s’épuisant dans la consommation, mais plutôt, au sens moderne du terme, comme l’idée d’« effectuer un exercice », de « fonctionner » (en parlant d’une machine) ou encore de « pouvoir être façonné » (« se travailler ») 40 Ces différents sens du mot travail sont attestés à la deuxième moitié du XIXe siècle par Alain Rey dans son Dictionnaire historique de la langue française (2001).. On retrouve ici la séparation qu’opère Hannah Arendt entre le « travail » (laborieux) et « l’œuvre » (qui fonde le monde commun) 41 Hannah Arendt, op. cit., distingue entre le travail, l’œuvre et l’action.. Mais conserver le terme de façon positive. Situé du côté du faire, le travail non économisé renvoie, pour Pierre-Damien Huyghe, à une dépense de temps sans assurance de rendement :
« D’une manière générale, la modernisation de l’économie se réalise comme économie du sens spatial localisé du travail. Cela veut dire, à rebours, que la situation du travail non moderne (c’est-à-dire ce travail encore non économisé et non organisé sur le mode moderne) est une situation de dépense de temps. C’est encore, si l’on veut, une situation de mise en jeu, dans une action productrice, d’une temporalité hors de calcul 42 Pierre-Damien Huyghe, « Un appareil de travail », dans : Martine Tabeaud, Richard Conte, Yann Toma (dir.), L’usine dans l’espace francilien, Paris, publications de la Sorbonne, 2001, p. 100.. »
Ce type de travail, qui s’oppose à « l’économie de la dépense pratique dans une technique calculée 43 Ibid. », interroge directement le design, qui suppose, depuis la Renaissance, une séparation entre fabrication et conception. Or la dimension pratique de l’action productrice conteste précisément la vieille opposition entre dessin et dessein en montrant que l’idée n’existe jamais seule, sans travail. Autrement dit, il y aurait dans le design, si on le replace dans l’acception non moderne du travail explicitée par Pierre-Damien Huyghe, une capacité à faire dériver une intention dans le processus même de la production. Une telle idée va bien entendu à l’encontre de la compréhension du design comme « réponse à des besoins » ou comme « résolution de fonctions », puisque ce type de formule maintient l’idée d’un calcul préalable dont la validité pourra être vérifiée après coup, sans que la « gestation » ne fasse question. Relisant sous cet angle les textes fondateurs du Bauhaus, Pierre-Damien Huyghe fait de l’écart entre l’emploi et le travail une situation possible pour que de l’art ou du design puisse avoir lieu :
« La capacité de résistance à la forme industrielle du progrès appartient à la technique en soi. C’est, pour paraphraser une formule issue des premiers écrits de Kandinsky, un élément de la technique en résonance intérieure. Ce mode de la technique implique un véritable travail (une gestation) et non seulement un emploi (ou une mise en service) des facteurs de la production 44 Pierre-Damien Huyghe, Art et industrie. Philosophie du Bauhaus, Belval, Circé, 1999, p. 119. La conclusion de cet essai est, à notre connaissance, la première fois où la distinction emploi/travail est explicitée sous cet angle.. »
Le design comme travail de l’inemployable
Le design, paradoxalement, peut donc être pensé comme une activité non rentable, si on le replace dans son apparition au tournant de la révolution industrielle où l’on savait déjà produire des objets sans lui. Que le design se soit ensuite majoritairement intégré aux différentes strates du capitalisme évoquées plus haut n’est pas une fatalité. En tant qu’êtres humains, c’est-à-dire en tant qu’individus dont les relations ne s’épuisent pas dans du prévisible, les designers (du moins ceux qui nous intéressent) œuvrent à faire différer des attentes économiques. Dans le champ du design typographique, par exemple, la somme des caractères existants couvre depuis longtemps la quasi-totalité des langues. Pourtant, la création de nouvelles polices n’a jamais été aussi vive que ces dernières années, relancée en partie par les problématiques multilingues, l’optimisation de l’affichage à l’écran ou encore par le recours aux licences libres (permettant notamment des approches contributives 45 Voir pour exemple la fonderie libre www.velvetyne.fr). Il en va de même dans la mode ou dans le mobilier, où la création ne se limite pas au registre fonctionnel. Si une bonne partie de ces objets alimente certes la société de consommation, ce qui importe est surtout que le design s’attache à des « qualités » de natures diverses : esthétiques, tactiles, sonores, spatiales, etc.
Ce travail, qui complique l’idéal d’une chaîne de production sans heurts, n’en est pas moins essentiel — précisément en raison de son inutilité. Ainsi compris, le design peut permettre de répondre à la question de départ, à savoir qu’il s’agit moins de chercher à ne pas travailler 46 Voir : David Frayne, The Refusal of Work. The Theory and Practice of Resistance to Work, Londres, Zed, 2015. que de cultiver des brèches, de rechercher des situations où quelque chose de nouveau puisse avoir lieu. Alors qu’une légion de dispositifs met à mal l’emploi salarié en générant une employabilité infinie non rémunérée 47 Sur le « devenir majordome » des employés, voir : Saul Pandelakis, « ‹ Done by app › : du design de services au quadrillage du réel », à paraître dans MEI, no 41, 2017., il importe de briser cette dynamique négative. Se placer dans une « temporalité hors de calcul 48 Pierre-Damien Huyghe, « Un appareil de travail », op. cit.. » (Huyghe), permet de penser des modes de travail qui seraient non employables, et dès lors subversifs, à même de transformer des environnements a priori fermés.
Un tel design, inemployable, c’est-à-dire qui ne participe pas d’une instrumentalisation des relations humaines, n’est pourtant pas sans valeur. Les projets réalisés par l’architecte et designer Ettore Sottsass dans les années 1970 sont à ce titre révélateurs d’une démarche interrogeant les fondements de la culture industrielle, et plus globalement « des lois, des habitudes et du vocabulaire de la culture rationaliste 49 Ettore Sottsass Jr., Métaphores [1972–1978], éd. établie par Milco Carboni et Barbara Radice, trad. de l’italien par Béatrice Arnal, Paris, Skira/Seuil, 2002, p. 9. ». Ses photographies et constructions fébriles érigées en pleine nature défient, par leur absurdité, la prétention de l’être humain à contrôler le monde :
« Qui décide si le soleil entrera dans ma chambre ou si au contraire il n’entrera jamais ? Qui décide si je pourrai continuer à travailler à mon bureau ou si au contraire je dois m’en aller et ne pourrai jamais plus y travailler ? Sortirai-je par la grille de l’usine et n’y retournerai-je jamais plus ? Qui décide cela ? Le destin seul décide-t-il [ou est-ce moi] qui décide [ou est-ce] quelqu’un d’autre ? Que vient faire le design dans cette histoire ? Peut-être serait-il préférable de s’habituer à dessiner pour la liberté […] de l’homme plutôt que pour la liberté des affaires 50 Ettore Sottsass Jr., « Dessins pour les droits de l’homme », ibid., p. 83.. »
Cette recherche d’un « lieu où le métier prend forme et sens dans le tissu de l’existence 51 Barbara Radice, ibid., p. 11. » retrouve sans nostalgie un certain « principe du métier », et montre que d’autres voies sont possibles que celles qui économisent l’existence.
Notes
1 Jonathan Crary, 24/7. Le capitalisme à l’assaut du sommeil, Paris, Zones, 2014.
2 L’épisode 5 de la 3e saison de la série Black Mirror (« Men Against Fire », scénarisé par réalisé par Charlie Brooker et réalisé par Jakob Verbruggen) en donne une vision saisissante : des soldats équipés d’implants cérébraux sont dressés à ne plus ressentir d’empathie pour l’ennemi. Afin de les maintenir dans un état de vigilance continue, leur sommeil est « géré » par la génération de rêves fantasmatiques, devenant ainsi un instrument de contrôle.
3 Pierre-Damien Huyghe, « Le principe du métier », Ateliers d’Art, no 100, juillet-août 2012, p. 56-58.
4 Karl Marx, Manuscrits de 1844, trad. de l’allemand par Jean-Pierre Gougeon, Paris, Flammarion, 1999.
5 Voir : Sophie Fétro, « Œuvrer avec les machines numériques », Back Office, no 1, février 2017, p. 86-97.
6 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne [1958], trad. de l’anglais par Georges Fradier, Paris, Pocket, coll. Évolution, 2001, p. 217.
7 Françoise Piotet, Emploi et travail, le grand écart, Paris, Armand Colin, 2007, présentation du livre par F. Giraud.
8 Bernard Stiegler, La technique et le temps, tome 3, Le temps du cinéma et la question du mal-être, Paris, Galilée, coll. La philosophie en effet, 2001.
9 Bernard Stiegler, « Quand s’usent les usages : un design de la responsabilité ? », entretien avec Catherine Geel, Saint-Étienne, Cité du Design, Azimuts, no 24, 2004, p. 85.
10 Bernard Stiegler, « Quand s’usent les usages : un design de la responsabilité ? », op. cit.
11 Voir par exemple le dossier « Finance, rente et travail dans le capitalisme cognitif » dirigé par Yann Moulier-Boutang dans : Multitudes, no 32, printemps 2008.
12 Voir : Bernard Stiegler, La Société automatique, tome 1, L’avenir du travail, Paris, Fayard, 2015.
13 Bernard Stiegler, Ariel Kyrou, L’emploi est mort, vive le travail !, Paris, Mille et une nuits, 2016.
14 Ibid.
15 Dominique Boullier, « L’âge de la prédation », InternetActu.net, septembre 2012, Cet article est une réponse au livre de Nicolas Colin et de Henri Verdier L’âge de la multitude. Entreprendre et gouverner après la révolution numérique (2012).
16 Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
17 Voir : Tristan Nitot, Surveillance://, Caen, C&F, 2016.
18 Là où les compagnies de cartes bleues type VISA peuvent savoir quand un couple va divorcer, Facebook serait capable de prédire l’évolution des sentiments amoureux par une analyse sémantique des interactions.
19 Evgeny Morozov, « La prise de pouvoir des données et la mort de la politique », Blog de Paul Jorion, août 2014.
20 Voir : Yves Citton (dir.), L’économie de l’attention, Paris, La Découverte, coll. Sciences humaines, 2014.
21 Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.
22 Trebor Scholz (dir.), Digital Labor. The Internet as Playground and Factory, New York City, Routledge, 2013. Voir aussi : Dominique Cardon, Antonio A. Casilli, Qu’est-ce que le Digital Labor ?, Paris, INA, coll. « Études et controverses », 2015.
23 Hubert Guillaud, « Digital Labor : comment répondre à l’exploitation croissante du moindre de nos comportements ? », InternetActu.net, 12 novembre 2014.
24 Claire Richard, « L’homme le plus connecté du monde s’est fait dévorer par ses données », Rue89.NouvelObs.com, 9 septembre 2016.
25 Graham Ruddick, « Admiral to price car insurance based on Facebook posts », TheGuardian.com, 2 novembre 2016.
26 James Vincent, « This smart toothbrush claims to have its very own ’embedded AI’. Don’t blame me, I didn’t invent capitalism », TheVerge.com, 4 janvier 2017.
27 Karissa Bell, « L’Oreal’s smart hairbrush can tell you if you’re ruining your hair », Mashable.com, 4 janvier 2017.
28 Manon des sources, « Les soucis judiciaires du We-Vibe, un sextoy un peu trop connecté », LeTagParfait.com, 19 décembre 2016.
29 « ‹ Smart › is the deodorant for bad ideas – a magic adjective that makes horrible products less stinky. » : tweet de Evgeny Morozov du 6 janvier 2017
30 Voir : Anthony Masure, « L’intelligence en défaut des smart cities », RevueSurMesure.fr, 5 janvier 2017.
31 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, op. cit., p. 97-98.
32 Evgeny Morozov, « La prise de pouvoir des données et la mort de la politique », op. cit.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Christian Fauré, « De la bureaucratie en Amérique », 18 octobre 2015, Christian-Faure.net : « D’ailleurs, combien d’applications de smartphones ne sont-elles rien d’autres que de nouveaux formulaires à remplir, même si elles nous sont présentées comme de ‹ simples formalités › ? »
36 Céline Mordant, « Droit à la déconnexion : y a-t-il une vie après le travail ? », LeMonde.fr, 17 mars 2016.
37 « Archéologie des notifications numériques », communication avec Saul Pandelakis dans le cadre du colloque scientifique « Archéologie des médias et écologies de l’attention », dir. Yves Citton, Emmanuel Guez, Martial Poirson et Gwenola Wagon, Cerisy-la-Salle, juin 2016.
38 Aurialie Jublin, « Comment l’employabilité a-t-elle tué le temps libre ? », InternetActu.net, 2 novembre 2016.
39 Hannah Arendt, op. cit.
40 Ces différents sens du mot travail sont attestés à la deuxième moitié du XIXe siècle par Alain Rey dans son Dictionnaire historique de la langue française (2001).
41 Hannah Arendt, op. cit., distingue entre le travail, l’œuvre et l’action.
42 Pierre-Damien Huyghe, « Un appareil de travail », dans : Martine Tabeaud, Richard Conte, Yann Toma (dir.), L’usine dans l’espace francilien, Paris, publications de la Sorbonne, 2001, p. 100.
43 43. Ibid.
44 Pierre-Damien Huyghe, Art et industrie. Philosophie du Bauhaus, Belval, Circé, 1999, p. 119. La conclusion de cet essai est, à notre connaissance, la première fois où la distinction emploi/travail est explicitée sous cet angle.
45 Voir pour exemple la fonderie libre www.velvetyne.fr
46 Voir : David Frayne, The Refusal of Work. The Theory and Practice of Resistance to Work, Londres, Zed, 2015.
47 Sur le « devenir majordome » des employés, voir : Saul Pandelakis, « ‹ Done by app › : du design de services au quadrillage du réel », à paraître dans MEI, no 41, 2017.
48 Pierre-Damien Huyghe, « Un appareil de travail », op. cit..
49 Ettore Sottsass Jr., Métaphores [1972–1978], éd. établie par Milco Carboni et Barbara Radice, trad. de l’italien par Béatrice Arnal, Paris, Skira/Seuil, 2002, p. 9.
50 Ettore Sottsass Jr., « Dessins pour les droits de l’homme », ibid., p. 83.
51 Barbara Radice, ibid., p. 11